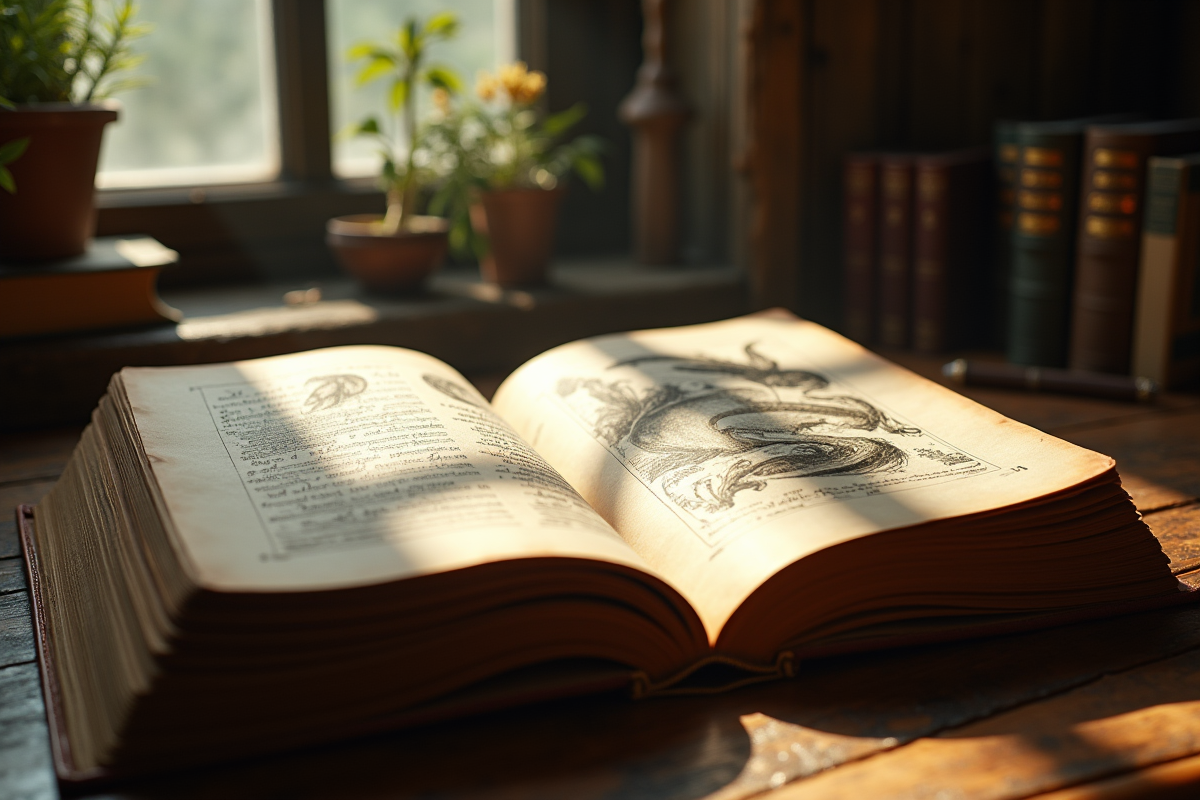Jusqu’au XIXe siècle, la majorité des naturalistes considérait que les espèces restaient identiques au fil des générations. Cette conception, longtemps dominante, s’opposait à toute idée de transformation des êtres vivants. L’apparition de courants évolutionnistes a bouleversé cet ordre établi et provoqué d’intenses débats scientifiques.
Certains penseurs et institutions ont continué à défendre l’immuabilité des espèces malgré l’accumulation de preuves contraires au fil du temps. Cette position a eu une influence durable sur la classification biologique et la compréhension des mécanismes de la vie.
Le fixisme : un concept clé pour comprendre l’histoire des sciences naturelles
Le fixisme s’appuie sur une affirmation tranchée : les espèces, telles que nous les connaissons, n’ont jamais changé depuis leur origine. Cette idée, solidement ancrée dans la pensée scientifique pendant des siècles, s’articule autour d’un lien étroit avec le créationnisme. La doctrine puise sa légitimité dans la Bible et s’est vue confortée par l’académie des sciences de Paris. La France, notamment au XVIIIe et au début du XIXe siècle, a été un terreau fertile pour cette vision, portée par des figures majeures comme Georges Cuvier.
Cuvier, naturaliste éminent, défend l’idée que les espèces sont immuables et développe la théorie du catastrophisme. Selon lui, la Terre aurait traversé des catastrophes successives ; à chaque crise, des espèces s’éteignent et d’autres surgissent, créées de toutes pièces. Ce schéma, variante du fixisme, entend répondre à la présence de fossiles d’animaux disparus, sans jamais envisager leur transformation au fil du temps.
À ses côtés, Carl Linné structure la taxonomie moderne et consolide l’idée que chaque espèce détient des caractères fixes, attribués dès l’origine. Ce cadre, fondé sur l’autorité des textes sacrés, a profondément marqué l’histoire des sciences naturelles.
Voici les grandes lignes qui structurent la pensée fixiste :
- Immutabilité de l’espèce : chaque espèce existe depuis la Création, inchangée.
- Fondement biblique : la Bible reste la référence pour expliquer la diversité du vivant.
- Catastrophisme : Cuvier avance que des crises successives expliquent la disparition et l’apparition d’espèces.
Le modèle du fixisme s’oppose frontalement à l’émergence de l’évolutionnisme, qui s’imposera plus tard avec Lamarck puis Darwin. Durant le XIXe siècle, les débats entre partisans du fixisme, tenants du catastrophisme et défenseurs du transformisme n’ont cessé de nourrir la réflexion scientifique, révélant à quel point l’observation du vivant pouvait bousculer les certitudes ancrées dans la tradition et la religion.
Quelles sont les origines et les influences majeures du fixisme ?
Le fixisme trouve ses fondements dans le créationnisme, doctrine inspirée des textes bibliques qui affirme la création d’espèces inaltérables par une volonté supérieure. Cette vision a structuré la pensée scientifique jusqu’au XIXe siècle, favorisée à Paris par l’influence de l’académie des sciences et de nombreux naturalistes français convaincus que chaque espèce possède des caractères figés dès son apparition.
Le catastrophisme de Georges Cuvier introduit un déplacement subtil : au lieu de remettre en cause la fixité des espèces, il imagine des extinctions massives, suivies de créations nouvelles, pour expliquer la succession des faunes dans les strates géologiques. Ce modèle rencontre un écho favorable auprès de figures telles qu’Élie de Beaumont ou Alcide d’Orbigny. Henri Ducrotay de Blainville, quant à lui, défend la « création unique », tandis que Marcel de Serres propose l’idée d’une « création continuée », avec l’apparition de nouvelles formes à différentes époques.
Pour mieux comprendre les soubassements du fixisme, on peut distinguer trois grandes tendances :
- Créationnisme : recours aux récits bibliques pour affirmer la permanence des espèces.
- Catastrophisme : lecture des fossiles à travers le prisme de crises naturelles répétées, sans évolution progressive.
- Débats et variantes : opposition entre création unique, création continuée et défenseurs d’une lente transformation du vivant.
À la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ces positions s’opposent aux premières théories transformistes, incarnées par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. L’emprise du fixisme sur la recherche naturaliste française a pesé lourd jusqu’à l’émergence de l’évolutionnisme, qui viendra ébranler l’idée d’espèces immuables.
Principales idées du fixisme : entre permanence des espèces et créationnisme
Le fixisme érige en principe la stabilité absolue des espèces depuis leur apparition. Cette conception, héritée du créationnisme et des textes bibliques, inscrit le vivant dans une organisation figée. Selon cette doctrine, chaque être aurait été créé d’emblée dans sa forme définitive, sans modification ni évolution au fil des générations. Les défenseurs du fixisme voient dans l’origine des espèces la marque d’un dessein intelligent ou d’une volonté supérieure.
L’idée d’immutabilité écarte toute notion de transformation ou d’évolution spontanée. Les travaux de Carl Linné sur la classification, fondés sur des critères morphologiques constants, ont consolidé ce modèle au sein de la taxonomie moderne. Face à la diversité des fossiles, le catastrophisme de Georges Cuvier propose que des catastrophes successives aient effacé des faunes entières, suivies, non d’une transformation, mais de l’apparition de nouvelles espèces toutes aussi immuables, sans lien de parenté avec les précédentes.
Les variantes du fixisme se déclinent principalement selon deux axes :
- Création unique : selon Henri Ducrotay de Blainville, toutes les espèces seraient apparues simultanément.
- Création continuée : pour Marcel de Serres, de nouveaux êtres vivants apparaîtraient à différentes périodes, mais sans altérer les formes déjà existantes.
Aujourd’hui, la version la plus récente du créationnisme, appelée dessein intelligent, reprend cette idée d’une organisation vivante ordonnée et finalisée. Les partisans du fixisme persistent à rejeter la notion d’évolution progressive, considérant chaque espèce comme le produit d’un acte initial, complet, irréversible.
Fixisme et théories de l’évolution : points de divergence et débats scientifiques
Le fixisme se distingue par une conviction sans concession : les espèces ne changent pas, ni par le temps, ni par l’environnement. Face à cette position, le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck, puis la théorie de l’évolution de Charles Darwin, proposent une vision radicalement opposée de la diversité du vivant. Dès le début du XIXe siècle, Lamarck suggère que les formes vivantes se modifient sous l’effet de l’usage, du milieu, et que les caractères acquis se transmettent. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire s’inscrit dans ce courant, alimentant de vifs échanges au sein de l’académie des sciences.
L’année 1859 marque un tournant avec la parution de L’Origine des espèces de Darwin. Sa théorie de la sélection naturelle explique l’adaptation et la diversification des espèces sans intervention surnaturelle, misant sur l’accumulation de petites variations successives. Les arguments des évolutionnistes s’appuient sur l’étude des fossiles, l’anatomie comparée, et, plus tard, sur la génétique et la biologie moléculaire. La découverte de la succession ordonnée des fossiles, l’émergence des dinosaures, la reconnaissance de formes intermédiaires minent progressivement l’édifice du fixisme.
Pour saisir d’un coup d’œil les principales oppositions, ce tableau synthétise les deux modèles :
| Fixisme | Évolution |
|---|---|
| Immutabilité des espèces | Transformation progressive |
| Création unique ou continuée | Sélection naturelle, adaptation |
Aujourd’hui, la communauté scientifique mondiale a tranché : l’explication évolutionniste s’impose, nourrie par les avancées de la paléontologie, de la génétique et de la biologie moléculaire. Mais les débats passionnés du XIXe siècle n’ont rien perdu de leur vigueur historique. Ils rappellent combien chaque révolution intellectuelle commence par un affrontement entre certitudes anciennes et regards neufs sur la vie.